Le jeu vidéo s’est beaucoup inspiré des codes du cinéma. On assiste aujourd’hui à un retournement de situation : de plus en plus de films sont tirés de jeux vidéo, pour un résultat qui n’est pas toujours à la hauteur des attentes. Après le carton plein de Resident Evil: Afterlife, le Vortex effectue un zoom complet sur la saga Resident Evil au cinéma, orchestré par Capcom, Paul Anderson et l’actrice vedette Milla Jovovich. Plongez avec nous au coeur de Raccoon City, ses hordes de zombies et les sombres desseins de l’organisation Umbrella. Attention : ça va saigner !
Resident Evil, par Paul W.S. Anderson (2002)

Premier épisode de la saga Resident Evil adapté au grand écran, le film éponyme met en situation un virus hautement mortel se propageant à un rythme effréné et mettant fin à toute vie humaine. Aidé des S.T.A.R.S., la belle Alice va tenter d’infiltrer le laboratoire d’où provient la menace et de neutraliser la Reine Rouge, l’intelligence artificielle des lieux que l’on tient pour responsable de l’apparition de l’épidémie mortelle.
Alice (Milla Jovovich) et Spencer sont mariés et propriétaires d’un luxueux manoir proche de Raccoon City. Officieusement, tout ceci n’est qu’une couverture : le couple est chargé par Umbrella (une multinationale spécialisée dans les technologies de pointe) de garder l’accès de la « Ruche ». Il s’agit d’un laboratoire expérimental souterrain et autarcique.
Alice contre une Reine Rouge coriace
Un groupuscule écologiste cherche à s’infiltrer afin de rapporter des preuves de recherches illégales sur les armes biologiques, et détruire ainsi la puissante firme. Alice leur servait de contact et devait voler le virus « Tyrant », mais non seulement Spencer l’a fait avant elle, mais il a propagé le virus dans la Ruche par les voies de ventilation. Spencer pensait tirer un bon prix du virus, mais il n’a pas eu le temps de s’échapper : la Reine Rouge (l’IA contrôlant la sécurité) l’a enfermé. Tous ceux qui ne sont pas changés en zombies perdent temporairement la mémoire à cause d’un gaz neurotoxique libéré par elle. Alice se réveille dans le manoir, amnésique. Un commando de l’USS l’entraîne dans la Ruche. L’USS doit désactiver la Reine Rouge dans les plus brefs délais, et surtout comprendre pourquoi elle a apparemment tué tout le personnel.

Une première adaptation plaisante pour les fans du jeu vidéo
La trame originelle de Resident Evil est globalement respectée, puisqu’on assiste pendant 1h30 à la lutte d’une poignée d’hommes et de femmes pour leur survie. Mais dès le début, on sent la volonté de Paul Anderson de changer le rythme du jeu pour en faire un film nerveux. La bande-son branchée “métal” (Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Slipknot, Fear Factory) colle parfaitement à l’action. De nombreux clins d’œil au premier jeu émaillent le film : des corbeaux effrayent Alice, des dobermans infectés la poursuivent. Les lieux sont identiques : manoir immense, laboratoire clandestin. Des éléments de Resident Evil 2 sont aussi inclus : la fuite en train, le Licker, Alice vêtue de la même robe rouge qu’Ada Wong. Paul Anderson se paye même le culot de copier une scène tirée du film Cube de Vincenzo Natali (le commando de l’USS doit prendre des poses de yoga afin d’éviter les rayons laser lancés par la Reine Rouge).
La scène marquante de la salle aux lasers
La salle aux lasers a séduit le créateur des jeux, Shinji Mikami, si bien qu’il l’inclue dans Resident Evil 4 en 2005. Ce passage du film au jeu plait aux deux publics, spectateurs et gamers. Mais il est tellement exploité (le film Resident Evil : Extinction et le jeu Resident Evil : Umbrella Chronicles en 2007) qu’au lieu de devenir une référence, la scène finit par être tout à fait ridicule et superflue. Autrement, la Reine Rouge est réutilisée dans Resident Evil : Extinction et le jeu Resident Evil : Umbrella Chronicles. La fin du film correspond à l’ouverture de Resident Evil 3, Alice est libre d’explorer la ville dévastée par le virus T.

Des monstres pas si effrayants que ça
A l’instar d’un World War Z, les véritables stars du film sont les zombies : le travail effectué sur les différents maquillages est remarquable. Néanmoins, on revoit toujours les mêmes têtes au cours du film. Concernant l’aspect visuel, les ados qui regardaient Mortal Kombat des étoiles plein les yeux ont grandi depuis… En 2002, les effets spéciaux ne font plus peur : les trucages numériques sur les dobermans infectés sont assez pitoyables. De même pour les maigres combats qui spolient Matrix sans jamais en avoir la classe. Et cela empire avec le temps : il est encore plus difficile d’être immergé dans l’action aujourd’hui quand l’aspect plastique repose sur des ficelles aussi mal dégrossies. Le pire reste le Licker. Milla Jovovich fait ce qu’elle peut pour sembler effrayée par ce tas de polygones, mais comment y croire une seconde ? Le plus drôle reste la tête en feu du Licker, qui hurle, même sans corps. Bref, un film plein de bonne volonté – parfois involontairement comique – mais qui n’arrive jamais à convaincre totalement sur le terrain de l’horreur.
La bande-annonce de Resident Evil
Resident Evil : Apocalypse, par Alexander Witt (2004)


La suite de Resident Evil sort dans les salles de cinéma deux ans plus tard. Alice, encore plus puissante que jamais, est rejointe dans son combat par Jill Valentine, une ancienne membre des forces spéciales d’Umbrella. Nos deux héroïnes vont alors lutter ensemble pour éradiquer le virus mortel ayant plongé Raccoon City dans le chaos et tenter de mettre un terme à la menace Némésis. Après Paul W.S. Anderson, c’est au tour d’Alexander Witt d’endosser la panoplie de réalisateur. Cette passation de pouvoir a t-elle portée ses fruits ?
Une Alice survitaminée sous menace nucléaire
L’action reprend là où le premier film s’était arrêté : Alice (Milla Jovovich) est capturée dans le manoir d’Arklay. Les scientifiques d’Umbrella lui administrent une nouvelle version du virus T. Contre toute attente, le “Projet Alice” réussit : Alice dispose à présent de capacités de combat surhumaines (son agilité, sa force et sa vitesse sont sur-développées.)
Mais pendant ce temps, les soldats d’Umbrella introduits dans la Ruche se font infecter. Les zombies accèdent à la sortie et contaminent Raccoon City. Alice y découvre une ville en proie aux zombies et aux Lickers. Umbrella, qui exerce des pressions financières sur les autorités publiques, décide de couper la ville du reste du monde en établissant un gigantesque périmètre de sécurité. Alice se retrouve prisonnière avec le reste de la population, des milliers d’infectés pour une poignée de survivants. Elle rencontre les membres de l’unité d’élite de la ville, les STARS. Ils n’ont que quelques heures pour s’échapper car Umbrella à l’intention de lancer une charge nucléaire suffisamment puissante pour raser la ville. Cette action aura pour mérite de stopper la contamination, mais surtout de détruire toutes les preuves.
Le Dr. Ashford, à l’origine du virus T, trahit Umbrella et entre en contact avec Alice. On apprend que le virus T avait à l’origine un but médical, en régénérant les cellules mortes. Umbrella en a fait une arme biochimique incontrôlable. Le Dr. Ashford offrira à Alice une évacuation par hélicoptère à une condition : qu’elle retrouve sa fille perdue dans la ville.
Quand la surcharge pyrotechnique noie le budget d’un film
Le succès du premier film (102 millions de dollars) est tel qu’il relance la mode des films de zombies. Capcom décide de faire une suite, mais Paul Anderson est trop accaparé par un autre projet : Alien vs Predator. C’est donc un parfait inconnu, Alexander Witt, qui est chargé d’appliquer à la lettre le scénario préparé par Paul Anderson. Si l’histoire s’inscrit dans la continuité, il n’en va pas de même dans la manière de filmer l’action. On attend plus quarante minutes avant de voir les premiers zombies, on est servi immédiatement par paquet de quinze. On passe des couloirs exigus de la Ruche aux grandes allées commerciales de Raccoon City; de la crainte de se faire contaminer à la panique de se voir dévorer sur place par une horde de zombies. Le film a bénéficié de plus de moyens, c’est indéniable. Hélas, le réalisateur opte pour le parti pris de Paul Anderson : édulcorer le contenu gore du jeu. Les acteurs ont tendance à surjouer, quand ce ne sont pas des scènes entières qui sont ratées (Alice qui rentre dans une église à moto, ou bien le Némésis qui parodie Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2…) On assiste à un festival de Gatling et de lance-roquette, mais on ne voit jamais personne mourir dans l’action. La violence est camouflée par des flashs et des effets pyrotechniques à tout bout de champ. Il faut dire que le film est encore une fois interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie.
De nombreux clins d’oeil au jeu vidéo
Capcom a joué à fond la carte du “fan service” avec moultes références à Resident Evil 3 : Jill Valentine apparait vêtue comme dans le jeu (elle constitue un personnage doublon par rapport à Alice). Carlos Oliviera et Nikolai sont présents, ainsi que le Némésis. Enfin, une bombe éradique la ville tandis que les héros sont évacués en hélicoptère. Resident Evil 2 est aussi de la partie avec le camion fou qui renverse tout sur son passage, ou la quête de la fille disparue, qui correspond à celle de Sheryl. Le plus bel hommage reste celui envers Resident Evil : Code Veronica, lorsque Alice est arrêtée par un commando d’Umbrella. Elle lâche son gun pour mieux le rattraper et les élimine avant de toucher le sol. En dépit de son budget conséquent et de sa plus grande fidélité à l’univers de la saga, ce second film est plus raté que le premier Resident Evil. Mais il rapporte encore plus : 130 millions de dollars, d’où une énième suite à venir.
La bande annonce de Resident Evil : Apocalypse
Resident Evil : Extinction, par Russell Mulcahy (2007)


La terre promise de l’Alaska en ligne de mire
Le virus mis au point par les laboratoires Umbrella a finalement détruit la quasi totalité de l’humanité. Les survivants nourrissent un maigre espoir d’atteindre l’Alaska, le dernier endroit sur Terre censé être protégé du virus. Alice rejoint un groupe de combattants non infectés à la recherche de cette terre promise et va devoir user de ses nouveaux pouvoirs pour venir à bout des morts-vivants et de l’organisation Umbrella.
Allant plus loin que ses prédécesseurs, Resident Evil : Extinction est encore plus violent et – à l’image de l’intensité que l’on retrouve dans le récent World War Z – met en scène des zombies beaucoup plus vifs capables de courir. Russell Mulcahy à la baguette tente une fois de plus de restituer l’ambiance survival-horror propre à la saga.
Dans Resident Evil : Apocalypse, Raccoon City avait été détruite par une frappe nucléaire orchestrée par Umbrella. Dans ce nouvel épisode, non seulement la souche du virus T a survécue, mais en plus le virus attaque de nouvelles formes de vie comme les plantes et l’eau. En l’espace de cinq ans, le continent américain a fini par ressembler à un désert. Continent après continent, l’humanité est au bord de l’extinction.
Une Alice encore plus puissante (si si, c’est possible)
Alice (Milla Jovovich) apprend à maîtriser les pouvoirs psioniques (guérison accélérée, télékinésie, pyrokinésie, champ de force et ondes de choc) conférés par la symbiose du virus T avec son organisme. Les rares survivants ont besoin de son aide pour rejoindre l’Alaska, seule région non infectée du fait de son isolement. Pendant ce temps, les scientifiques d’Umbrella tentent d’élaborer un vaccin à partir du sang d’Alice. L’ADN extrait durant sa précédente captivité est utilisé afin de concevoir des clones, et ainsi fournir des sujets de recherche à l’infini. L’Alice originale est de nouveau repérée, mais le jeu du chat et de la souris s’inverse : c’est elle qui traque les dirigeants d’Umbrella.


Le film en tête du box office américain dès le jour de sa sortie
Le succès des films rend Capcom euphorique. Le premier film Resident Evil avait rapporté 17,7 millions de dollars le weekend de sa sortie en 2002, Resident Evil : Apocalypse avait ensuite fait mieux avec 23 millions de dollars en 2004. Le troisième film a pour objectif de s’emparer de la tête du box-office américain, ce qui sera chose faite le jour de sa sortie avec 24 millions de dollars en 2007. Après l’Apocalypse, voici le temps de l’Extinction.
Paul Anderson est encore plongé dans un autre projet, La course à la mort, mais fournit une fois de plus le scénario. Capcom confie la réalisation à Russell Mulcahy, (auteur de la trilogie Highlander). Resident Evil : Extinction est plus violent que les précédents films même s’il n’y a à vrai dire qu’une seule scène de combat contre les zombies. Comme ce sont des cobayes d’Umbrella infectés par le sang d’Alice, ils peuvent désormais courir. Ces zombies spéciaux font référence au remake du premier jeu sur Gamecube, les « Crimson Head ». Leur voracité fait plaisir à voir, de même que le show d’Alice, une machette à chaque main. Les effets spéciaux sont plus réussis grâce à un budget accru et une sortie encore récente.
Une suite too much mais jubilatoire
En revanche, le déferlement de morts est peut-être un peu trop démonstratif, si bien que le suspens et le sentiment de peur s’évanouissent. Autre fait notable : l’introduction du “Game Over”. Le réalisateur s’amuse à nous faire croire que c’est l’originale qui meurt, alors qu’il s’agit de clones d’Alice. Ludique, sauf que les “Continue” infinis évacuent toute tension dramatique. La scène de domestication d’un zombie traité au sang d’Alice est hilarante. Au contraire, une autre scène avec un groupe de survivants est assez désespérante : plutôt que d’aider les autres et de repousser les inévitables hordes de zombies, ces sadiques s’amusent à piéger les survivants en attendant de mourir eux-mêmes.
Parfois, le réalisateur en fait un peu trop. Tels ces clins d’oeil appuyés (passages obligés de la salle aux rayons laser, des dobermans et des corbeaux contaminés / pillage systématique de la trilogie Mad Max (1979-1985) de George Miller / reprise de la problématique de Day of the Dead du pauvre George Romero). Des personnages importants du jeu apparaissent comme Claire Redfield et Albert Wesker, mais leur présence à l’écran est anecdotique. À la fin du film, Alice combat un Tyrant ressemblant à celui du premier jeu. Les nouveaux pouvoirs d’Alice l’apparentent plus à une super-héroïne de Comics qu’à un être humain susceptible de mourir, donc d’éprouver la peur. Ce film est sans aucun doute celui qui s’éloigne le plus de l’univers des jeux, mais conserve quelques scènes jubilatoires.
La bande-annonce de Resident Evil : Extinction
Resident Evil : Afterlife, par Paul W.S. Anderson (2010)


Parapluies japonais et Alaska en approche
En quête de l’Alaska providentiel, Alice poursuit son voyage à la recherche de rescapés et sa lutte contre Umbrella. Un piège mis en place par la terrible organisation est d’ailleurs en train de se refermer sur les survivants.
Resident Evil : Afterlife s’ouvre sur les parapluies des habitants de Tokyo. Premier clin d’œil au jeu vidéo : Umbrella signifie « parapluie », et la multinationale arbore un logo de cette forme (le studio Capcom, à l’origine des jeux vidéo de la saga Resident Evil, est bien entendu Japonais). Passé le résumé des films précédents, Alice (toujours incarnée par Milla Jovovich) nous entraîne quatre ans plus tard, en pleine attaque du laboratoire souterrain d’Umbrella situé à Tokyo.
Paul Anderson nous refait le coup du “Game Over”, puisqu’Alice meurt dans l’assaut. Ses clones tentent de finir le travail, mais Wesker réussit à s’échapper en hélicoptère militaire. Cette scène n’est d’ailleurs pas sans rappeler le décollage final de Chris et Claire Redfield dans Resident Evil : Code Veronica.
Une Alice increvable qui redevient humaine
Le trajet en hélicoptère est l’occasion de changer les rôles entre Wesker et Alice. Wesker lui administre un sérum, ce qui annule tous les pouvoirs du virus T, et la rend de nouveau humaine. Bizarrement, Alice survit au crash de l’hélicoptère, et pas Wesker, contraint de s’injecter au dernier moment le virus T. Alice se rend ensuite en Alaska pour rejoindre les survivants laissés à la fin de Resident Evil : Extinction. Arrivée sur place, elle ne trouve personne à l’exception de Claire Redfield, en furie. L’issue du combat est la même que dans Resident Evil 5 : une fois débarrassée du dispositif en forme de scarabée, Claire retrouve ses esprits. En survolant Los Angeles en avion, Alice trouve des survivants regroupés dans une prison qui leur sert de refuge. A leur contact, elle apprend que “Alaska” n’est pas l’État des États-Unis, mais le nom d’un paquebot amarré à quelques kilomètres de la prison.
En arrivant sur l’Alaska, Alice tombe dans le piège de Wesker, qui se sert de cet appât pour capturer des hommes non infectés. Il retarde en fait la folie inhérente au virus T en ingérant de l’ADN humain intact. Alice est un met de choix puisqu’en intégrant sa génétique supérieure, Wesker pourra reprendre le contrôle de lui-même. Sauf qu’elle le tue par la ruse, et accomplit les promesses de l’Alaska. Désormais, le navire offre réellement une protection et de la nourriture aux survivants.


Un joli raté cinématographique
Pas de chance pour Paul Anderson, je suis allé voir Piranha 3D la semaine avant la sortie de Resident Evil : Afterlife. Autant dire que le principal argument du film, à savoir de la cervelle rance et des tripes étalées en 3D, me laisse froid. Disposant d’un budget de 56 millions de dollars, on aurait mérité un film avec de “vrais acteurs dedans”. Mais non, le casting est exclusivement constitué par des inconnus et des acteurs de seconde zone, c’est-à-dire issus des séries américaines : Wentworth Miller (Prison Break), Kim Coates (Sons of Anarchy), et Ali Larter (Heroes).
Certains zombies sont des Majinis, les êtres infectés de Resident Evil 5 : leurs têtes s’ouvrent en quatre pour laisser découvrir une mâchoire avide de steak haché. On retrouve également le “bourreau à la hache”, repris tel quel dans le film. Seulement, rien ne vient expliquer l’arrivée de ces nouveaux ennemis. Tout comme dans le jeu, le “bourreau” meurt au bout d’une heure de film, en qualité de semi-boss. Il aurait pu par exemple avoir un background aussi étoffé que le Némésis. Le montage de Resident Evil : Afterlife cumule les incohérences, les raccourcis faciles, et élude les scènes avec un potentiel dramatique. Ce serait supportable si le film compensait ses lacunes par une ambiance décalée à la Shaun of the Dead. Hélas, Paul Anderson respecte le cahier des charges de Capcom en annihilant tout aspect humoristique et gore.
Le film est aussi divertissant que l’intégrale de l’Inspecteur Derrick en comparaison au festival d’outrances de Piranha 3D. Que reste-t-il ? 1h30 d’action non-stop. Paul Anderson a beau clamer avoir employé le même système de caméra que pour Avatar, on se retrouve à l’arrivée avec un “sous Matrix” en 3D. L’abus de scènes au ralenti tourne le film en ridicule, et finit par lasser au point de nous faire décrocher. On se réveille pour le combat final entre Alice et Wesker. Mais la scène est tellement calquée sur le combat opposant Néo à l’agent Smith que Resident Evil : Afterlife se prend une dizaine d’années de retard dans les dents. Le film s’achève sur un “cliffhanger” dans lequel Jill Valentine fait son retour, annonçant un cinquième film. J’ai tapé du poing sur le fauteuil.
La bande-annonce de Resident Evil : Afterlife
Resident Evil : Retribution, par Paul W.S. Anderson (2012)


Après un Resident Evil : Afterlife en demi-teinte, Paul W.S. Anderson persiste et signe avec le cinquième opus cinématographique de la saga du plus célèbre survival-horror de sa génération.
Le come back des héros
Resident Evil : Retribution est un Best of maladroit. On y retrouve la plupart des personnages des précédents films – y compris les tués (Michelle Rodriguez : Rain Ocampo / Sienna Guillory : Jill Valentine / Oded Fehr : Carlos Oliveira, Shawn Roberts : Albert Wesker, la Reine Rouge) et bien sûr Milla Jovovich : Alice. Cette dernière (ou plutôt, ces dernières, puisque les clones d’Alice meurent généralement dans des Game over sanglants) est projetée dans des reconstitutions de mégapoles (Tokyo, New York, Washington D.C. et Moscou) qui sont autant de niveaux de jeu vidéo, jusqu’à l’affrontement traditionnel contre le Boss des zombies.
Cependant, tout n’est pas à jeter : Paul W.S. Anderson maitrise beaucoup mieux la 3D que dans Resident Evil : Afterlife, le budget rehaussé de 65 millions de dollars se voit à l’écran (ça pète toutes les 5 minutes), et les remixes des thèmes musicaux des jeux vidéo flattent l’oreille des gamers. Pas de quoi faire un sixième film, et pourtant, Paul W.S. Anderson et Milla Jovovich renchaînent les tournages !
Un scénario alambiqué en manque de substance
Entre les multiples clones d’Alice, les héros morts qui sont en fait vivant (et bien portant), les simulations de combat organisées par Umbrella plus réelles que virtuelles, les méchants qui deviennent gentils et inversement, le spectateur s’y perd un peu. A moins que tous ces artifices et ficelles scénaristiques ne soient là que pour cacher la misère : Alice court et tue des zombies pendant 1h30, point barre. Scénario zéro, et ce n’est pas l’ajout de personnages cultes (Léon S. Kennedy, Ada Wong et Barry Burton) et du virus Las Plagas – sans aucune explication tangible – qui vont arranger les choses. Un petit conseil : boycottez Resident Evil : Retribution pour aller voir Silent Hill : Revelation 3D, hélas non scénarisé par Roger Avary et non réalisé par Christophe Gans.
La bande-annonce de Resident Evil : Retribution
Resident Evil : Chapitre Final, par Paul W.S. Anderson (2017)
Sixième et dernier épisode de la saga, Resident Evil: Chapitre Final est prévu pour février 2017. Paul Anderson est une dernière fois à la baguette d’un film censé mettre un terme à l’épopée d’Alice sur grand écran. En attendant de voir s’il ne s’agit pas là de l’épisode de trop (et peut être pas non plus le dernier malgré l’annonce du synopsis), je vous laisse en compagnie de la bande-annonce. Enjoy !
La bande-annonce de Resident Evil : Chapitre Final


Rédacteur en chef du Vortex. Amateur de Pop-Corn.
Créateur de singularités.

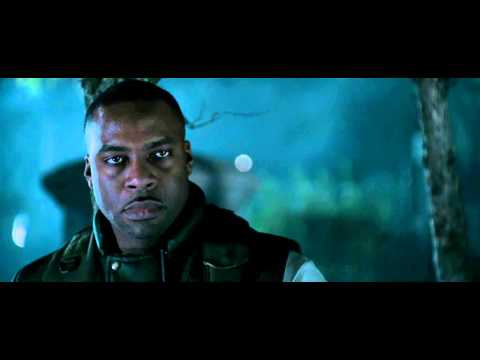
![Resident Evil: Extinction - Official® Trailer [HD]](https://www.le-vortex.com/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyteCache.php?origThumbUrl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F2VVEAkYlA8o%2F0.jpg)









